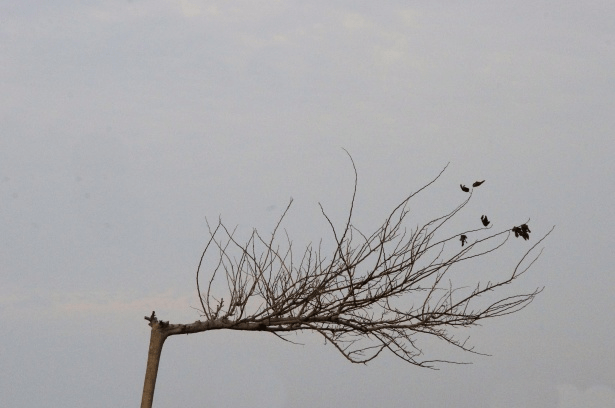
Voici plusieurs mois que je n’avais rien publié. Ce n’est pourtant pas faute d’aligner les pages d’écriture. Mais le travail de réflexion entamé exige encore une durée conséquente.
Tout à commencé avec mon dernier article « A quoi se préparer et comment ? Penser la soutenabilité critique des territoires » (mai 2025). Le constat d’un échec programmé de l’approche « transition douce » n’était pas une surprise.
Mais l’esquisse d’un monde réellement viable, sur le long terme, devint plus tangible. Il me fallait donc poursuivre : il ne suffisait pas de dire que nous ne savions pas vraiment encore à quoi pourrait ressembler un monde respectant les limites planétaires.
Il fallait argumenter un récit, entendu non pas comme une utopie à la Fourier, mais comme une rêverie réaliste et donc « opérationnelle ». Il était par conséquent indispensable d’étayer cette mise en forme d’un mode de vie pérenne, par des chiffres, des estimations d’émissions et d’empreinte carbone, de surfaces et d’empreinte écologique. C’est ce qui est aujourd’hui en cours avec l’élaboration d’un modeste « modèle » de territoire, composé de quelques 50 000 habitants, partiellement autonome, sobre, robuste et capable d’encaisser les chocs à venir.
Entretemps, j’ai pris connaissance de nombres de documents et rapports. Que ce soit le dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat (juin 2025) ou le plus récent rapport de la Cour des Comptes (septembre 2025). J’ai relu les 149 propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, ou encore les dernières publications du Shift Project, l’une de leur dernière pépite étant sans nul doute leur rapport fait en partenariat avec AéroCarbo sur les leviers de décarbonation du secteur aérien…
Toutes ces proses généreuses et teintées de « positivisme à tout prix », ont un point en commun : elles ne sont que des fables, pas des récits. Et c’est, entre autres choses, pour cette raison que nous n’éviterons pas une multitude de désastres, un long et « sale » crash.
Formulé autrement, c’est notre déni, notre sous-estimation de la gravité de la situation et surtout notre incapacité à regarder en face les contraintes telles qu’elles se posent, qui causeront inéluctablement de lourdes pertes humaines.
Pourquoi ces littératures sont-elles des fables ?
Pour une raison fort simple : aucune d’entre elles ne s’aventurent à évaluer les dispositifs qui seraient nécessaires d’instaurer afin de garantir une authentique « neutralité carbone ». Autrement dit, aucun de ces travaux n’examine sérieusement les dispositifs de captation et de stockage indispensables pour compenser nos émissions anthropiques — ce qu’on appelle le removal.
Toutes ont tendance à raisonner selon l’approche « trajectoire » du GIEC que l’on pourrait résumer ainsi : « il faut réduire nos émissions si nous ne voulons pas dépasser 1,5 ou 2 °C avec x % de chances de réussite ».
Or, poser le problème uniquement en termes de budget carbone par rapport à un seuil à ne pas franchir soulève deux difficultés majeures.
D’une part, on en vient à tolérer des « indices de confiance » qui reviennent à accepter de jouer à la roulette russe, ou encore à se résigner à l’émission de plusieurs centaines de gigatonnes futures en se disant que cela ne fera « que » + x °C, et que « tout va bien » puisque le seuil n’est pas encore atteint !
D’autre part, ce type de raisonnement ne permet pas de concevoir des territoires en véritable neutralité carbone, reposant uniquement sur des solutions fondées sur la nature. En effet, tous les modèles qui projettent un maintien sous les deux degrés supposent le recours à des technologies artificielles de captation (captage à la source, aspiration du CO₂ dans l’atmosphère ou géo-ingénierie) — des technologies qui ne sont aujourd’hui absolument pas opérationnelles et qui risquent fort de ne jamais l’être.
C’est pourquoi j’ai entamé cette réflexion sur un territoire durable (au sens littéral : qui peut durer !), avec une autre approche : tenter de dépeindre les possibles modes de vie, desquels ne résulterait aucun gramme de GES supplémentaire dans l’atmosphère (1), voire qui permettraient d’avoir une empreinte négative, en rajoutant à cela les contraintes de l’ensemble des neufs limites planétaires.
Quel removal ?
Pour mieux visualiser la problématique et les enjeux, nous allons déjà tenter d’estimer, à l’échelle du territoire français, les capacités réelles de captage et de stockage de nos émissions anthropiques (en sachant, comme nous l’avons précisé, qu’il y aura bien d’autres contraintes à prendre en compte).
Pour poser les termes de l’équation, il nous d’abord considérer notre empreinte carbone globale et pas seulement les émissions territoriales. Pour mémoire 369 MtCO₂e (brut, hors puits existants) étaient émises sur notre territoire en 2024. Or, si nous intégrons les flux physiques de nos exportations et importations (donc les quantités de GES incorporées aux produits concernés), notre empreinte carbone totale s’élève à quelques 644 MtCO₂e (2023) (2).
C’est ce tonnage qui doit être « absorbé », chaque année, si nous voulons atteindre une effective neutralité carbone.
Or, pour disposer d’un removal de long terme (et non simplement capter du carbone pour le relâcher quelques mois plus tard), il faut savoir qu’il n’existe que deux grands leviers principaux :
- les forêts, à condition qu’elles ne dépérissent pas et qu’elles soient gérées pour rester en croissance permanente, tout en valorisant le bois d’œuvre en produits de longue durée de vie ;
- la filière biochar, qui transforme une partie de la biomasse (résidus de haies, déchets verts non agricoles, connexes de scierie), sans compromettre la production de compost, en un solide riche en carbone, extrêmement stable et relargué à un rythme très lent.
Au-delà des forêts et du biochar, il existe bien d’autres pratiques capables d’accroître temporairement les stocks de carbone : la restauration des haies, la remise en état des tourbières et zones humides, l’agroforesterie au sens large (arbres intraparcellaires, ripisylves) ou encore l’augmentation du carbone des sols grâce au maraîchage sur sol vivant, aux prairies permanentes ou aux apports organiques.
Ces leviers sont précieux, mais leur effet doit être clairement compris : ils ne constituent pas des puits annuels pérennes, comme peut l’être la production de biochar ou certains stockages minéraux. Ils correspondent plutôt à un gain ponctuel, un « one shot » : après quelques décennies, les milieux atteignent un nouvel équilibre et cessent d’absorber du CO₂ supplémentaire.
Prenons l’exemple des haies : avec environ 700 000 km encore présents en France, leur capacité de stockage est estimée entre 0 et 4,8 tCO₂/km/an selon les contextes, soit 1 à 3 MtCO₂/an au total. Une restauration massive, visant à retrouver les 2 millions de kilomètres historiques, pourrait porter ce potentiel entre 4 et 8 MtCO₂/an (3).Toutefois, cet effet resterait temporaire s’il n’était pas couplé à une filière biochar. En effet, les haies ne peuvent croître indéfiniment : pour qu’elles contribuent durablement au stockage du carbone, il faut valoriser les résidus issus de la taille et de l’entretien en biochar, permettant ainsi de transformer un flux biologique temporaire en stockage de très long terme.
Autrement dit, toutes ces solutions renforcent les stocks de carbone existants, mais elles ne constituent pas des puits récurrents mobilisables année après année.
Le removal des forêts
Contrairement aux pratiques ponctuelles de restauration des stocks de carbone (tourbières, sols, agroforesterie), les forêts gérées en croissance continue offrent la possibilité d’un removal annuel récurrent.

Chaque année, les arbres en croissance absorbent du CO₂, et si le bois prélevé est transformé en produits de longue durée de vie (charpentes, poutres, mobilier, etc.), ce carbone reste stocké pendant des décennies, voire plus. Ce double mécanisme — absorption biologique et stockage durable sous forme de bois d’œuvre — permet de maintenir un flux régulier de captation, à condition que la forêt soit entretenue pour rester en phase de croissance. Si nous gérons intelligemment nos forêts, il s’avère que celles-ci pourraient capter entre 30 à 45 MtCO₂e/an. Mais pour que ce potentiel devienne effectif, il est indispensable de transformer profondément notre approche : mieux protéger les massifs contre les incendies, diversifier les essences pour renforcer leur résilience face aux sécheresses et aux maladies, et prévoir une seconde vie longue aux produits bois en fin d’usage. À cette fin, le couplage avec une filière biochar — valorisant le bois usagé pour un stockage quasi permanent du carbone — constituerait un levier essentiel.
Le removal « biochar »
Le biochar est une technique simple de removal mais souvent mal comprise. Il s’agit de chauffer des résidus végétaux (élagages urbains, déchets verts, connexes de scierie, tailles de bords de routes et chemins, etc.) à l’abri de l’oxygène. C’est la pyrolyse. Sous l’effet de la chaleur, une partie de la biomasse se volatilise en gaz et vapeurs (les « gaz de pyrolyse »), et une autre partie se recompose en carbone solide : le biochar, un charbon végétal très aromatique et extrêmement stable dans les sols. Les gaz de pyrolyse ne sont pas perdus : ils sont brûlés dans une chambre chaude pour fournir la chaleur du four (autothermie). Cette post-combustion émet du CO₂, mais c’est du CO₂ biogénique – celui-là même que la plante avait capté – et, surtout, une fraction significative du carbone initial est « verrouillée » dans un solide durable, qui peut rester dans les sols pendant des décennies à des siècles. La différence avec une décomposition naturelle (ou un brûlage à l’air libre) est radicale : au lieu que tout reparte en CO₂ (et parfois en CH₄), une part devient un stock lent.

Pour 1 tonne de résidus secs, le rendement en biochar est typiquement de ~30 %. Le biochar obtenu contient ~75 % de carbone, dont ~65–80 % est considéré comme « très stable » (persistance séculaire). En pratique, cela correspond à environ 0,54 tCO₂e de removal pérenne par tonne de biomasse sèche pyrolysée.
Ainsi, à l’échelle nationale, le biochar pourrait contribuer à la séquestration de 1,0 à 1,6 MtCO₂e/an, voire jusqu’à 3 MtCO₂e/an(4) dans certains usages spécifiques (par exemple comme additif au ciment). Ce stockage est particulièrement intéressant car il convertit en carbone solide très stable des résidus végétaux qui, laissés à l’air libre, se seraient décomposés rapidement et auraient relâché leur carbone sous forme de CO₂ ou de CH₄. Dans ce cas, il s’agit bien d’un removal additionnel et durable, mesurable à l’échelle des décennies à des siècles. La seule limite méthodologique concerne les résidus qui auraient contribué à l’humus des sols : là, le bénéfice net est plus difficile à établir, car les sols eux-mêmes ne sont pas des puits infinis et atteignent tôt ou tard un équilibre. En résumé, le potentiel de séquestration du biochar est réel et robuste, mais son ampleur exacte dépendra des types de biomasse mobilisés et de la gestion globale des sols.
Surgit le réel dans lequel on se cogne…

Nous commençons à entrevoir l’ampleur du problème ! Si l’on additionne l’ensemble des leviers naturels et biosourcés évoqués les ordres de grandeur restent relativement modestes. Dans un scénario « réaliste » à court terme — c’est-à-dire en consolidant le puits forestier, en restaurant une partie du linéaire de haies, en développant un usage raisonné du biochar, en réhumidifiant les tourbières et en généralisant certaines pratiques de stockage dans les sols — nous pourrions, peut-être, atteindre 37 à 60 MtCO₂/an d’ici à 2030 (à condition que les méga incendies ne viennent pas ruiner nos efforts !).
Dans une perspective encore plus ambitieuse (et donc périlleuse), avec une mobilisation large et soutenue de tous les leviers à l’horizon 2050, le plafond paraît se situer autour de 50 à 75 MtCO₂/an. Ce chiffre est cohérent avec les estimations indépendantes, comme celles de Carbon Gap, qui évaluent à 76 MtCO₂/an le potentiel de captation diversifiée pour la France à cette échéance.
Cela signifie que pour atteindre la neutralité carbone, il serait nécessaire d’émettre 8.6 à 14.28 fois moins ! Une descente vertigineuse qui serait à effectuer en moins de 20 ou 30 ans.
Dans le même temps, et toujours en urgence, nous aurions également à reconstituer des gigantesques aires de biodiversité (réensauvagement), nous devrions stopper net le mouvement d’artificialisation des sols, cesser tout usage de pesticides, diminuer drastiquement les pollutions et la surexploitation des ressources (minières notamment) de par le monde !
Le premier enseignement de ces constats est sans appel : la « transition douce et progressive » est une lubie.
Jamais les populations des pays industrialisés (dans leur écrasante majorité) n’accepteront un tel bouleversement de leurs vies. Les décroissants radicaux que nous sommes demeureront ultra minoritaires.
Par conséquent, nous ne prenons guère de risque en pronostiquant que le déni de masse va se poursuivre. Les compagnies pétrolières (c’est d’ailleurs ce qu’elles viennent d’annoncer) vont extraire toujours plus de pétrole. Quelques « efforts » (?) seront faits ou plutôt « affichés » ici et là, dans un registre de greenwashing délirant. Les grandes (et moins grandes) banques vont continuer à nous vendre « la finance verte ». La répression, à l’encontre des individus et groupes taxés « d’écoterrorisme » va se renforcer encore et encore. Les guerres pour les ressources, ce qui est notamment, en partie, le cas de l’Ukraine et de la Palestine, vont s’accélérer (les guerres de l’eau ont débutées partout sur la planète y compris en Europe). Le fascisme est au pouvoir dans de nombreux pays. En France, il n’est pas « aux portes » mais déjà confortablement installé dans le salon, dans l’attente des prochaines échéances électorales…
Il demeure néanmoins une interrogation : jusqu’à quel point le système économique peut-il tenir face aux chocs écologiques qui vont crescendo ? La raréfaction des ressources va aiguiser les tensions sociales et générer de multiples frustrations et colères (jusqu’aux émeutes de la faim). Les systèmes assurantiels sont sous haute tension et vont devoir réviser en profondeur leurs garanties. Les coûts économiques des reconstructions après les épisodes catastrophiques (tous plus « inédits » les uns que les autres !) vont être exponentiels. L’explosion de bulles financières (comme celle, clairement identifiée, de l’IA) va avoir un impact bien plus important qu’en 2008, les Etats ayant encore à cette époque des marges d’endettement (5). Les bâtiments seront durement touchés. C’est ce que l’on appelle le retrait des sols argileux : plus de la moitié des maisons individuelles devraient se fissurer. Il existe également un risque sévère sur les rendements agricoles, qui pourraient se retrouver très rapidement en chute libre, entraînant un cortège de pénuries, disettes et famines.
Disons-le sans détour : un effondrement rapide, aussi brutal et dévastateur soit-il pour nos sociétés thermo-industrielles, pourrait paradoxalement constituer une issue opérante pour rompre avec la trajectoire mortifère qui nous mène vers un monde inhabitable. Les conséquences seraient terribles — et frapperaient d’abord les plus vulnérables — mais un tel choc systémique reste une manière d’interrompre à temps l’emballement.
À celles et ceux qui objectent qu’il est absurde, voire immoral, de « souhaiter » un tel événement, nous répondrons qu’il n’est peut-être pas trop tard pour préserver la possibilité d’un monde encore vivable, mais qu’il est en revanche déjà bien trop tard pour éviter des centaines de millions, voire des milliards de morts. Le scénario le plus redoutable demeure celui d’un effondrement lent, « sale », s’étalant sur plusieurs décennies : une descente chaotique, subie, jalonnée de famines, de guerres et d’actes barbares (6).
Reste à savoir ce que nous faisons, maintenant.
Nous pourrions nous résigner en affirmant que rien n’est plus possible. Nous pourrions adopter le cynisme du « après moi, le déluge ». Nous pourrions, comme tant d’autres, choisir l’ignorance volontaire. Mais si nous acceptons de regarder nos enfants dans les yeux, alors une autre posture s’impose.
Cette posture appelle une stratégie à deux volets. D’abord, il est plus qu’urgent de nous préparer – non pas avec tout le monde mais avec toutes celles et tous ceux qui en ont la conscience et la volonté – à l’intensification des chocs : c’est la priorité absolue. Ensuite, comme nous l’avons évoqué en ouverture de cet article, il nous faut bâtir un récit concret d’un monde possible après l’effondrement. Non pas un récit de transformation volontaire de notre civilisation — puisqu’elle s’y refuse obstinément — mais un récit de reconstruction, sur les ruines du capitalisme, pour reprendre le titre de l’excellent ouvrage de George Monbiot (7).
Et ces éléments de récit ne sont pas que des projections pour demain : ils constituent dès aujourd’hui des matériaux précieux pour concevoir les archipels de résilience et de résistance dont nous avons un besoin vital, et ce dans les plus brefs délais.

Cap sur un « monde d’après » ?
Les premières conclusions de cette prospective sont rudes.
L’eau y est gérée comme un bien commun essentiel, et les territoires sont réorganisés selon la logique des bassins versants. L’agriculture a rompu avec l’élevage intensif : la surface agricole utile n’est plus accaparée à 70 % par le bétail. Rien ne garantit même que l’élevage de ruminants, fût-ce pour le lait ou la laine, reste compatible avec les contraintes futures. L’alimentation est majoritairement végétarienne, avec un peu de poisson d’élevage bio, produit en quantité modérée. Les seules pratiques admises sont agroécologiques.
Des mesures drastiques assurent la constitution de stocks collectifs d’eau et d’aliments. De vastes aires sont laissées au réensauvagement. Les habitats sont robustes, souvent semi-enterrés, pour résister aux tempêtes. Les bâtiments collectifs sont réduits à l’essentiel.
Il n’y a plus ni voitures, ni motos, ni trottinettes électriques. Pas d’avions dans le ciel. Les trains subsistent, mais dans des proportions limitées. La mobilité repose sur quelques bus électriques, des vélos, des chevaux, des carrioles et des vélotos.
L’énergie est limitée et strictement renouvelable, fournie surtout par des éoliennes verticales et des panneaux solaires de nouvelle génération (sans silicium) (8). La quantité disponible par habitant n’excède pas 20 GJ par an (≈ 5 500 kWh) (9). L’internet existe encore, mais réduit à l’essentiel : exit le streaming et l’hyperconnexion.
Une « éco-industrie » néo-artisanale se développe, s’appuyant sur le minage urbain (10): exploitation et reconditionnement de la masse phénoménale de matériaux déjà accumulés par l’humanité. Les cycles biogéochimiques sont bouclés — toilettes sèches pour toutes et tous. Un système de santé satisfaisant est maintenu, mais la prévention devient la pierre angulaire de la santé publique, et les accidents chutent drastiquement.
La publicité et le marketing digital ont disparu, entraînant avec eux des armées entières de communicants. Les activités minières sont réduites au strict nécessaire : quelques métaux de base (fer, cuivre, aluminium, étain, zinc, un peu de plomb), et de faibles quantités de nickel et de manganèse pour les alliages vraiment indispensables.
Est-ce un monde enviable ? La réponse est double. Pour celles et ceux qui ne sauraient accepter la déconnexion de leur smartphone, le retour obligé (par la force des choses) aux travaux de la terre, le renoncement au « tourisme autour du monde », à la vitesse, ou encore l’abandon du streaming permanent, la vie semblera horriblement spartiate. Mais pour d’autres, elle pourra être l’occasion de retrouver des liens humains véritables, de réinventer des solidarités multiples et de vivre des moments intenses de joie (sans sombrer dans un optimisme spinoziste !).
Est-ce un monde « durable » ? Sur le papier, oui. Mais nous ne rêvons pas d’un monde calme et paisible. Si nous ne pouvons pas esquisser de scénarios précis, une chose est certaine : les classes dominantes ne renonceront jamais à leur place dans la chaîne alimentaire. Milices privées, bandes fascistes ou forces de l’ordre corrompues : elles chercheront à maintenir un régime d’exploitation, une mainmise sur les ressources et les territoires stratégiques, afin d’assurer leur propre survie. Le monde d’après restera violent, et il faudra continuer à se battre pour des libertés jamais définitivement acquises. Quoi qu’il en soit, ce sera le monde de nos descendants — et peut-être encore le nôtre. À nous d’y insuffler du sens, de la dignité et du beau.
Régis Dauxois, le 2 octobre 2025
(1) : la concentration de GES dans notre atmosphère qui s’élève actuellement à quelques 424 ppm pour le seul CO2 et à environ 524 ppm en CO2e (équivalent). (source : https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/monthly.html ; https://www.csiro.au/en/research/environmental-impacts/climate-change/state-of-the-climate/greenhouse-gases )
(2) Source : SDES / l’Insee / le gouvernement. https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/fr/16-empreinte-carbone-et-emissions-territoriales
(3) INRAE, https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/etude-4-pour-1000-synthese-en-francais-pdf-2_0.pdf
(4) : Source Connaissance des Énergies https://www.connaissancedesenergies.org/sites/connaissancedesenergies.org/files/pdf-actualites/2024.06.27_Note-position-France-BIOCHAR_VF.pdf)
(5) En septembre 2025, la Deutsche Bank avertit que la bulle de l’IA est la seule chose qui maintient l’économie américaine à flot et que, « lorsque cette bulle éclatera, la réalité sera bien plus dure que ce que tout le monde imagine » https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/376214/La-Deutsche-Bank-avertit-que-la-bulle-de-l-IA-est-la-seule-chose-qui-maintient-l-economie-US-a-flot-et-que-lorsque-cette-bulle-eclatera-la-realite-sera-bien-plus-dure-que-ce-que-tout-le-monde-imagine/
(6) : Voir l’étude de l’Institute and Faculty of Actuaries, Planetary Solvency. https://actuaries.org.uk/news-and-media-releases/news-articles/2025/jan/16-jan-25-planetary-solvency-finding-our-balance-with-nature/
(7). Reconstruire sur les ruines du capitalisme. Sous-titre : s’émanciper par le partage et la coopération, George MONBIOT, Actes sud, 2021.
(8) panneaux pérovskites : le problème du plomb peut être résolu https://actu.epfl.ch/news/rendre-les-cellules-photovoltaiques-a-perovskite-p/
(9) voir notre fiche https://recitsanthropocene.net/quel-mix-energetique-100-renouvelables-quelle-quantite-denergie-produire/
(10) La masse mondiale créée par l’homme dépasse toute la biomasse vivante (Nature, 2020) https://www.nature.com/articles/s41586-020-3010-5
L’arraisonnement techno-prométhéen de la Terre va rencontrer ses limites, un jour où l’autre. D’ici là,… récupérons le futur (cf Innerarity) ! merci pour ce billet qui remet les idées à leur place !!
J’aimeAimé par 1 personne