Retour au menu
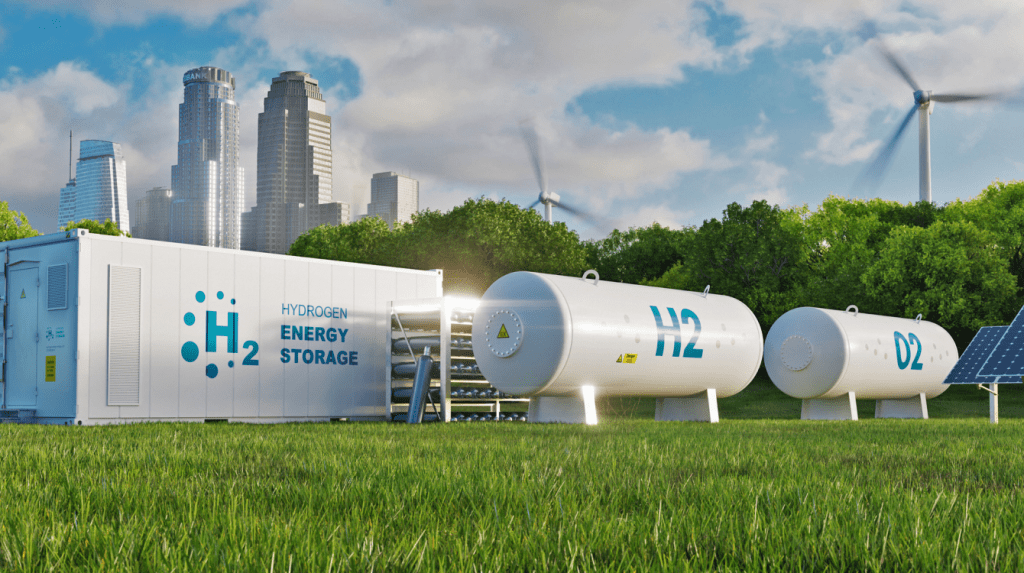
L’hydrogène est l’élément chimique le plus simple qui soit : son noyau ne contient qu’un proton, et son atome un seul électron. Dans la vie courante, on parle pourtant rarement d’hydrogène atomique, mais de dihydrogène, noté H₂, c’est-à-dire une molécule formée de deux atomes liés. Par abus de langage, on dit “hydrogène” pour désigner ce dihydrogène gazeux. Ce gaz n’est pas, à proprement parler, une source d’énergie au sens des gisements naturels de charbon ou de pétrole ; il est ce que les physiciens appellent un vecteur d’énergie : une forme transformée, dérivée, qui nécessite toujours une énergie primaire pour être produite, exactement comme l’électricité. Avant de pouvoir l’utiliser, il faut donc l’extraire d’une autre molécule – le plus souvent les hydrocarbures ou l’eau – en y consacrant de l’énergie.
Dans l’immense majorité des cas, le dihydrogène n’existe pas à l’état libre dans la nature. Il est lié à d’autres éléments, dans l’eau, les hydrocarbures, les biomolécules. Il existe toutefois quelques gisements naturels, rares et dispersés, que l’on regroupe sous le terme d’hydrogène naturel ou “hydrogène blanc”. On en a identifié en Russie, au Mali, et plus récemment en France, en Lorraine notamment. Ces découvertes ont suffi à relancer l’intérêt pour ce gaz, mais elles ne changent pas, pour l’instant, le fait fondamental que l’hydrogène que nous utilisons aujourd’hui est, pour plus de 95 %, fabriqué à partir d’énergies fossiles.
Les chiffres sont implacables : plus de 95 % du dihydrogène mondial est produit à partir de gaz naturel, de pétrole ou de charbon, par vaporeformage du méthane, oxydation partielle d’hydrocarbures ou gazéification du charbon. Ces procédés consistent à casser des molécules d’hydrocarbures sous l’action de la chaleur pour en libérer du dihydrogène. Ils sont, pour l’heure, les plus compétitifs économiquement, mais ils sont aussi massivement émetteurs de CO₂ : on estime entre 11 et 19 kilogrammes de CO₂ émis par kilogramme d’hydrogène produit. Utiliser cet hydrogène-là pour “verdir” notre économie n’a donc aucun sens : c’est seulement déplacer les émissions, en les rendant moins visibles.
C’est ce constat qui a fait émerger l’idée d’un hydrogène dit “bas carbone”, c’est-à-dire un hydrogène dont la production serait peu ou pas émettrice de CO₂.
Deux grandes voies sont alors envisagées. La première consiste à continuer à utiliser des énergies fossiles, mais en captant le CO₂ à la source pour le stocker dans le sous-sol. Cette option, qui s’inscrit dans la famille des technologies de capture et stockage du carbone, nous renvoie directement à la problématique de la géo-ingénierie : que fait-on de ce CO₂ capté ? Où le stocke-t-on ? Avec quels risques à long terme ? Ces questions sont traitées dans une autre fiche, consacrée à la “géo-ingénierie et au fantasme de toute-puissance”, mais il suffit ici de rappeler que l’idée d’un hydrogène fossile “propre” grâce à la captation repose sur des paris technologiques et géologiques extrêmement incertains.
La seconde voie est celle de l’électrolyse de l’eau. Dans ce cas, on utilise de l’électricité pour décomposer l’eau en dioxygène (O₂) et dihydrogène (H₂). Sur le papier, la solution est séduisante : si l’électricité provient de sources renouvelables, l’hydrogène produit n’émet plus de CO₂. Dans la pratique, tout dépend de deux conditions : la manière dont l’électricité est produite – ce scénario exclut ici le nucléaire – et le rendement global de la chaîne, depuis la production d’hydrogène jusqu’à son usage final.
Trois grandes familles d’électrolyse sont aujourd’hui étudiées et développées, par ordre de maturité décroissante.
– L’électrolyse alcaline est la plus ancienne, robuste, bien maîtrisée ; elle utilise un électrolyte liquide basique et fonctionne à des températures modérées.
– L’électrolyse à membrane échangeuse de protons (PEM) est plus récente et plus performante : à surface égale, elle produit davantage d’hydrogène, elle est plus compacte et se prête mieux à un fonctionnement flexible, ce qui la rend compatible avec l’intermittence des renouvelables. Mais cette performance a un prix : elle dépend de métaux nobles pour ses catalyseurs – platine, iridium – et de titane pour certaines parties des électrodes. Autant de matières premières rares, chères, parfois issues de chaînes d’approvisionnement fragiles ou contestables.
– Enfin, l’électrolyse à haute température, dite à oxydes solides, fonctionne avec de la vapeur d’eau portée entre 700 et 850 °C. Cette température très élevée permet d’atteindre des rendements jusqu’à 30 % supérieurs aux électrolyses alcaline et PEM, notamment lorsqu’on peut la coupler à de la chaleur dite “fatale” issue de l’industrie lourde – aciéries, cimenteries, verreries. Elle présente un autre avantage : elle ne nécessite pas de métaux nobles. En contrepartie, cette technologie souffre d’une dégradation accélérée des matériaux, de temps de démarrage longs, et reste encore relativement jeune pour pouvoir être déployée massivement avec la robustesse que supposerait un système énergétique sobre et durable.
D’autres voies sont parfois évoquées, notamment la production d’hydrogène à partir de la biomasse. Mais dans un monde où les terres, les forêts et les résidus organiques sont déjà sollicités pour l’alimentation, la construction, les sols, la biodiversité, détourner la biomasse pour en faire un vecteur gazeux supplémentaire apparaît peu pertinent. Les usages prioritaires de cette ressource sont ailleurs.
À ces contraintes de production s’ajoute une difficulté majeure : comment stocker et transporter ce gaz pour qu’il puisse jouer un rôle dans le système énergétique ?
À température ambiante et pression atmosphérique, l’hydrogène se présente sous forme de gaz peu dense et très volatil, en raison de la petite taille de ses molécules. Lorsqu’il n’est pas nécessaire de réduire le volume de stockage – par exemple pour des applications stationnaires –, on peut le conserver sous forme gazeuse à une pression relativement basse, entre 30 et 50 bars. Ce stockage est peu coûteux et techniquement bien maîtrisé. Mais dès qu’il faut transporter ou concentrer des quantités significatives, les choses se compliquent.
Le stockage sous forme liquide, à très basse température, est aujourd’hui l’apanage de quelques secteurs de très haute technologie, comme l’espace. Il permet de stocker beaucoup d’hydrogène dans un volume réduit, mais au prix d’un refroidissement extrême : environ –253 °C, sous une faible pression. Même avec des réservoirs très bien isolés, il est impossible d’éviter les pertes : le réservoir absorbe de la chaleur, le liquide se vaporise progressivement, la pression interne augmente et doit être soulagée. Ce phénomène, appelé boil-off, engendre des fuites inévitables, difficiles à concilier avec une utilisation sobre de l’énergie (fuites qui posent un réel problème car nous savons aujourd’hui que l’hydrogène est un GES indirect, voir étude citée dans les ressources ci-dessous, « Atmospheric Chemistry and Physics »).
Une troisième voie consiste à stocker l’hydrogène sous forme solide, à l’aide de matériaux capables d’absorber et de relarguer le gaz de manière réversible : les hydrures. Ces composés permettent d’atteindre des densités volumétriques élevées, supérieures à ce qu’offrent les réservoirs gazeux ou liquides. Mais cette densité volumique se paie en poids, puisqu’il faut compter non seulement la masse de l’hydrogène, mais aussi celle du matériau support. Dans un monde où chaque kilo compte, cette solution est loin d’être neutre.
Lorsque l’on considère l’hydrogène comme un moyen de stocker de l’électricité – le fameux schéma “Power-to-H₂-to-Power” –, une autre limite apparaît : le rendement global.
Produire l’hydrogène par électrolyse, le comprimer, le stocker, puis le retransformer en électricité dans une pile à combustible ou une turbine implique une succession de conversions, chacune accompagnée de pertes. Les analyses de l’ADEME estiment que le rendement global de cette chaîne tourne autour de 25 %, là où des batteries stationnaires peuvent dépasser les 70 à 75 %. Dans un exemple type de chaîne hydrogène avec compression à 350 bars, l’ADEME indique que pour obtenir 13,4 kWh en sortie, il faut 58,7 kWh en entrée : 45,3 kWh ont été perdus, soit 77 % de l’énergie initiale. Autrement dit, pour chaque mégawattheure d’électricité injectée dans un système hydrogène, seule une fraction – environ un quart – revient sous forme électrique.
Pour beaucoup d’auteurs, ce faible rendement suffirait à disqualifier l’hydrogène comme outil de stockage.
Pourtant, dans un système dominé par des énergies renouvelables variables, la question se pose autrement. Si l’on dispose d’heures où l’éolien et le solaire produisent bien au-delà de la demande, et si cette électricité excédentaire serait de toute façon perdue faute de débouchés, la possibilité de la convertir en hydrogène, même avec de fortes pertes, prend un autre sens. Il ne s’agit plus de comparer le rendement idéal de différentes technologies, mais de savoir si l’on préfère gaspiller purement et simplement l’électricité excédentaire, ou en conserver une partie sous forme chimique.
Dans ce cadre, l’hydrogène présente des avantages réels : une fois produit, il peut être stocké sur de longues durées, parfois plusieurs mois ou années, sans se décharger comme le font les batteries.
Il devient alors un outil de stockage saisonnier, capable de couvrir des creux prolongés de production renouvelable ou des pics de demande. Pour chaque MWh “en trop”, on pourra, en simplifiant, stocker environ 567 kWh sous forme d’hydrogène et, au moment voulu, en restituer environ 228 kWh sous forme d’électricité. Le rendement est faible, mais l’alternative, dans certains cas, serait une perte totale. L’hydrogène ne se substitue pas aux batteries ni aux stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) ; il vient compléter ces dispositifs pour les échelles de temps où ils sont peu pertinents : plusieurs mois, voire des saisons.
Dans un mix sobre et robuste, cette fonction de tampon longue durée est probablement l’un des rares rôles réalistes pour l’hydrogène. Elle doit rester marginale, encadrée, et ne jamais être invoquée comme prétexte pour éviter la sobriété ou pour surdimensionner les infrastructures électriques. D’autres solutions de stockage, parfois beaucoup plus simples, garderont toute leur place : STEP supplémentaires lorsque la géographie le permet, parcs de batteries stationnaires (idéalement sur des chimies plus robustes et moins problématiques que le lithium-ion, comme les batteries “carbone” ou des technologies fer-phosphate), stockage thermique massif couplé au solaire et à la chaleur fatale.
Reste la question des usages de l’hydrogène dans les transports, omniprésente dans les récits industriels récents.
L’exemple de la Communauté d’agglomération de Pau-Béarn-Pyrénées illustre bien la logique à l’œuvre. Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territoire, cette collectivité a choisi de développer une ligne de bus à haut niveau de service alimentée à l’hydrogène, en préférant cette option aux batteries électriques. Les arguments avancés portent sur l’autonomie des véhicules, la facilité et la rapidité de ravitaillement, la possibilité de ne pas surdimensionner le réseau électrique pour des recharges massives et simultanées. On retrouve des projets similaires pour des navettes maritimes, comme à Toulon.
Pris isolément, ces choix peuvent avoir une certaine cohérence, à condition que l’hydrogène utilisé soit effectivement produit à partir de sources renouvelables locales, et que l’on n’en fasse pas une solution généralisable à l’ensemble du parc de transport. Dans une perspective de sobriété, l’hydrogène peut éventuellement trouver sa place pour quelques usages très ciblés : transports collectifs sur des lignes fixes, logistique lourde, certaines applications industrielles. Mais il ne saurait en aucun cas devenir le vecteur de “la voiture individuelle à hydrogène pour tous” ou le carburant miracle qui permettrait de maintenir intacte la société du tout-transport.
Quant à l’hydrogène naturel ou “blanc”, récemment remis sur le devant de la scène, il mérite une mention, mais pas un fantasme.
On a longtemps cru qu’il n’existait pas de gisements significatifs d’hydrogène dans la croûte terrestre. Des découvertes récentes ont montré le contraire : au Mali, près de Bourakébougou, un gisement est exploité, pour l’instant avec un débit modeste ; en France, en 2022, un forage en Lorraine a mis en évidence un réservoir à un peu plus de 1 000 mètres de profondeur ; ailleurs, aux États-Unis, en Afrique, d’autres indices ont été détectés. La France a inscrit ce sujet dans le cadre de France 2030, en finançant des programmes de cartographie et de recherche sur des techniques d’extraction “respectueuses de l’environnement” (?), et un premier permis d’exploration a été délivré dans les Pyrénées-Atlantiques fin 2023.
Mais cette filière est, à ce stade, extrêmement immature. Les connaissances sur l’hydrogène naturel restent embryonnaires, les volumes réellement exploitables sont inconnus, et les questions liées à sa captation, à sa purification – ces gaz contenant souvent de nombreux contaminants – et à son modèle économique restent largement ouvertes. Même si ces gisements se révélaient importants, ils ne permettraient pas, à court terme, de couvrir les gigantesques volumes d’hydrogène que supposent les scénarios de décarbonation les plus énergivores. Là encore, compter sur un miracle géologique pour éviter de repenser nos usages serait une manière sophistiquée de repousser les questions de fond.
Au total, l’hydrogène apparaît donc comme ce qu’il est vraiment : un vecteur d’énergie coûteux, techniquement intéressant, mais structurellement limité, qui ne prend sens que dans un système déjà sobre, où l’essentiel de la demande a été réduit, où l’on a misé sur l’efficacité, la mutualisation, la relocalisation, et où l’on s’en sert pour ce qu’il sait faire mieux que les autres – le stockage longue durée, quelques process industriels, quelques mobilités collectives –, plutôt que de lui demander d’entretenir l’illusion d’une continuité sans rupture avec le monde d’avant.
___________________________
RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Avis de l’Ademe – Vecteur hydrogène dans la transition énergétique (2022)
Staffell et al. (2019) – The role of hydrogen and fuel cells in the global energy system
Revue académique majeure (Energy & Environmental Science) qui passe en revue tous les usages possibles (électricité, chaleur, industrie, transport, stockage) et fait le tri entre potentiel réel et « buzz ».
IEA – Global Hydrogen Review 2024
Rapport annuel de l’AIE : volumes actuels (encore ultra majoritairement “gris”), projets annoncés, coûts, politiques publiques, perspectives à 2030–2050.
IRENA (2019) – Hydrogen: A Renewable Energy Perspective
Synthèse techno-économique sur l’hydrogène “vert” (coûts, rendements, besoins en renouvelables, chaînes de valeur). Un peu daté mais toujours utile pour les ordres de grandeur et les cartes de potentiel.
Ocko & Hamburg (2022) + commentaires (Atmospheric Chemistry and Physics)
Série d’articles montrant que l’hydrogène est un GES “indirect” non négligeable et que les fuites peuvent rogner une partie des bénéfices climatiques si elles sont mal maîtrisées.