Retour au menu
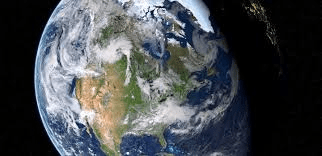
Avant d’aborder les notions de soutenabilité critique territoriale, de coopération ou de justice sociale, il est nécessaire de clarifier le cadre dans lequel toute réflexion sur l’avenir doit désormais s’inscrire : celui du réalisme biophysique.
Ce terme désigne l’obligation de penser nos sociétés à partir des lois de la physique, des limites de la biosphère, et des conditions d’habitabilité qui rendent la vie humaine possible. Ce réalisme n’est ni une position philosophique, ni un choix politique parmi d’autres. Il est simplement la reconnaissance que tout projet sociétal doit commencer par l’étude du monde réel, des contraintes matérielles qu’il impose, et des risques que l’on encourt lorsqu’on les ignore.
Au premier rang de ces contraintes se trouvent les limites planétaires, c’est-à-dire les seuils biophysiques au-delà desquels les grands systèmes terrestres se déstabilisent.
Ces limites – climat, biodiversité, cycles de l’azote et du phosphore, artificialisation, acidification des océans, ressources en eau douce – constituent la toile de fond incontournable de toute réflexion sur la transformation de nos sociétés. Leur interaction est complexe, mais leur signification est simple : si nous ne préservons pas les conditions biogéochimiques qui rendent la Terre habitable, aucune politique sociale, économique ou technologique ne pourra compenser la perte de stabilité des systèmes naturels. La priorité au vivant, au maintien des sols, des forêts, des cycles hydrologiques et du climat doit donc être considérée comme la condition première de toute soutenabilité véritable.
S’agissant de la limite climatique, ce réalisme implique une conséquence immédiate : la sortie accélérée des énergies fossiles.
Tant que nos infrastructures, nos mobilités, nos industries et nos logements reposent sur le pétrole, le gaz et le charbon, aucune trajectoire compatible avec la stabilité climatique ne peut être envisagée. Le problème majeur n’est pas l’insuffisance de « solutions techniques », mais la poursuite d’un modèle énergétique qui contredit frontalement les connaissances scientifiques. Sur ce point, les climatologues n’ont jamais été ambiguës : tant que les combustibles fossiles dominent l’économie, les niveaux de réchauffement franchiront les seuils dangereux, entraînant des effets en cascade sur les écosystèmes et les sociétés humaines.
À cela s’ajoute une dimension trop souvent oubliée : la responsabilité intergénérationnelle.
Nos décisions actuelles engagent la stabilité des mondes dans lesquels vivront nos enfants et petits-enfants. Transférer aux générations suivantes les coûts biophysiques et sociaux de nos modes de vie – qu’il s’agisse du réchauffement climatique, de l’effondrement de la biodiversité, de la dette écologique ou de la dégradation des ressources – reviendrait à leur imposer de vivre dans un monde diminué. L’humanité s’est longtemps comportée comme si les générations futures étaient un horizon abstrait. Le réalisme biophysique nous oblige à reconnaître que les choix faits aujourd’hui ne pourront plus être corrigés demain : les phénomènes d’irréversibilité, de dépassement et de basculement rendent cette responsabilité immédiate.
Dans ce contexte, le principe de précaution doit retrouver toute sa place.
Nous avons une fâcheuse tendance à lire les projections du GIEC comme des prédictions certaines, alors qu’elles sont assorties de degrés de confiance qui expriment explicitement les marges d’incertitude. Lorsque le GIEC indique qu’il reste, dans les scénarios les plus optimistes, une probabilité « d’au moins 50 % » de rester en deçà de +1,5 °C – parfois avec des dépassements temporaires – cela signifie littéralement que nous avons une chance sur deux d’y parvenir, et donc une chance sur deux d’échouer. S’en tenir à cet horizon minimaliste, et considérer qu’il constitue une cible raisonnable, revient objectivement à jouer à la roulette russe avec les conditions d’habitabilité de la Terre. Une telle attitude serait irrecevable dans n’importe quel autre domaine de la gestion des risques ; elle l’est d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un système planétaire dont dépendent les conditions de vie humaines.
L’un des effets les plus importants de ce réalisme biophysique est de transformer la manière dont nous concevons les politiques d’adaptation.
Pendant longtemps, celles-ci ont été calibrées sur les valeurs moyennes : les moyennes de température, de précipitations, de montée des eaux. Or ce ne sont pas les moyennes qui déstabilisent les sociétés, mais les extrêmes. Les vagues de chaleur humides, les pluies diluviennes, les mégafeux, les sécheresses structurelles, les tempêtes d’une intensité inédite sont les événements qui provoquent les ruptures systémiques. L’adaptation exige donc un basculement conceptuel : passer d’une logique de moyenne à une logique d’extrêmes, en dimensionnant les infrastructures, les bassins de rétention, les systèmes d’alerte, les bâtiments, les réseaux électriques et hydriques non pas pour le climat d’hier, mais pour les risques extrêmes de demain. Ne pas le faire, c’est préparer des territoires vulnérables aux chocs qui s’annoncent.
Enfin, toute réflexion de long terme oblige à repenser notre rapport à la technologie (voir notre fiche « Sur Le concept de solution« ).
La fuite en avant techno-solutionniste, portée par l’idée que chaque problème trouvera sa réponse dans une innovation future, est incompatible avec les limites planétaires. Le réalisme biophysique appelle un autre rapport aux techniques : non pas une technophobie, mais un usage choisi, maîtrisé, sobre, orienté vers l’émancipation et l’autonomie collective (une forme de discernement technologique). Les technologies doivent être réparables, locales lorsque c’est possible, compatibles avec la disponibilité réelle des matériaux, et alignées sur des objectifs de sobriété plutôt que d’expansion infinie. Elles doivent être au service des collectifs humains, et non l’inverse. Une technologie non soutenable, non réparable, dépendante d’une chaîne mondiale hautement vulnérable, n’est pas une technologie d’avenir : c’est un pari sur l’instabilité.
Ces remarques préalables constituent le socle de toute réflexion sérieuse sur la « transition » et plus exactement sur la bifurcation nécessaire.